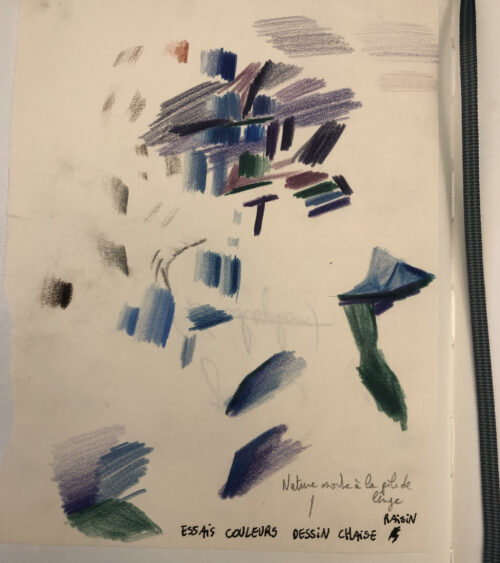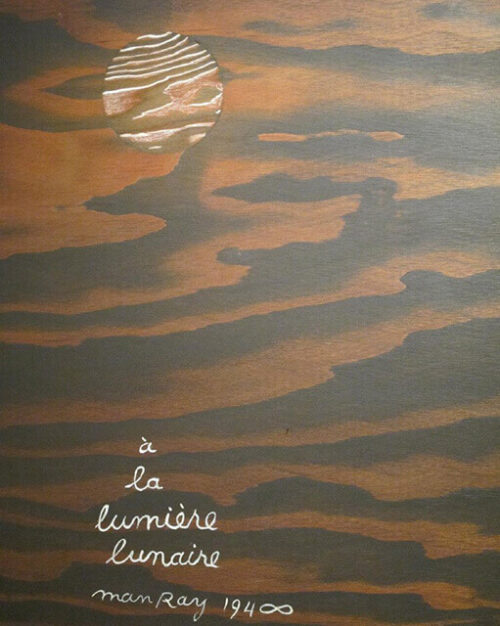Christian Bobin est mort. Je ne pourrai plus jamais lui écrire. Ça lui va bien de partir en automne, quand le froid dore les forêts. Chez lui, dans sa clairière, ce doit être très beau.
Il se tait mais il persiste, comme un très bel écho, et pendant un court instant j’ai pu mêler ma voix à la sienne : c’est tout ce qu’on peut espérer, je crois, de quelqu’un comme lui. Ça suffit à la beauté, ça adoucit le chagrin.
Je ne suis pas encore triste, mais ça viendra bientôt. Peut-être quand je te verrai demain ; peut-être que quand tu poseras sur moi tes yeux tristes et inquiets je pleurerai un peu. Mais, tu vois – tu le connaissais comme moi, puisque tu l’aimais autant – il portait en lui l’annonce de sa mort, la douceur du repos qui se prolonge, qui dure ; qui reste comme lui restait, paisible, contemplatif et bien d’accord avec la matière de l’air et la couleur des feuilles.
En rentrant à Rennes dimanche je relirai La Part Manquante, et là aussi, peut-être que le chagrin arrivera. Dans le train, hier, A… m’a appris son décès ; et en descendant à Montparnasse je suis allée me recueillir devant la maison d’Agnès Varda, que tu as aimée comme je l’aimais lui. Je t’ai pris ton lieu de recueillement, j’ai pensé que tu ne m’en voudrais pas. J’ai voulu être proche du sentiment que tu as eu, il y a quelques années. J’avais besoin d’un lieu pour accueillir ce que je ne savais pas encore formuler : des hommages, du deuil, du respect ; une certaine entente avec le monde.
Cher ami, nous avons parlé hier, alors je n’écris pas cette lettre pour toi, je me répéterais trop ; mais je l’écris tout de même, tu vois, j’en ai besoin. Et après t’avoir parlé, je crois, je lui parlerai, à lui. Je lui écrirai une dernière fois. J’ai toujours pensé que c’est très important de s’adresser aux morts. De ne pas les laisser seuls. (Je ne peux pas le croire. Je t’ai dit hier, au téléphone, que cette nouvelle ne me choquait pas ; qu’il m’a toujours paru « effacé », près de la nature, près du cycle des choses – ce que je n’ai pas formulé, mais qui est au fond l’idée que je voulais exprimer alors, doit être celle-là : tout comme ça lui allait bien de vivre, ça lui va tout aussi bien de mourir, et pour ça il mérite, je crois, mon respect éternel. Hier je t’ai dit ça, et tu étais d’accord avec le terme, mais tu étais tout de même plus surpris que moi. Et je pense que, alors, je n’avais pas vraiment saisi la réalité de ce qui était arrivé. Et maintenant, maintenant, le mot descend dans ma gorge. Je n’ose pas relire ses lettres, il le faudra pourtant. Il faudra le regarder dans les yeux.)
Cher ami, soyons tristes ensemble. Marchons main dans la main près de la Seine comme des personnages de la Nouvelle Vague, doucement, très doucement. Regardons les couleurs du bel automne et pensons qu’il est parti. J’ai hâte de te voir, toi qui pourras partager ma tristesse sans l’habiller de trop de mots, de trop de réconfort ; toi qui sauras quoi dire et quand te taire ; toi qui me raconte toujours de très belles histoires.
À demain.